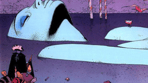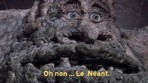Ma dépression
Introduction du voyage


Parce qu’il va falloir parler un peu de soi pour commencer cette affaire : si nous partons en exploration tous.tes ensemble dans le vaste paysage de la Mélancolie, on va se présenter, c’est plus poli comme ça.
J’ai patienté 37 ans avant d’entrer dans le monde caché de la dépression. Je dis : j’ai patienté et je n’ai pas sélectionné ces mots au hasard. J’ai patienté, rongé mon frein, souffert, avant d’accueillir mon diagnostic avec un soulagement libérateur. Ma dépression a démarré bien avant le verdict dans le cabinet du médecin. Elle me semble avoir toujours été là. Aujourd’hui, c’est une évidence. Avant cela, j’ai passé tout mon temps à m'interroger :
Mais qu’est-ce que j’ai ?
Je suis persuadée que vous êtes nombreux.se.s à avoir cheminé dans ce grand foutoir que l’on nomme existence avec ce point d’interrogation en guise d’épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Mais qu’est-ce que j’ai bordel ? Pourquoi je suis comme ça ?
S'accommoder du sentiment de décalage, de la difficulté au quotidien, c’est le petit plus qui fait notre humanité, la capacité de se construire sur à peu près n'importe quelle base, allez vogue, advienne que pourra. Comprendre que la souffrance mentale n’est pas normale, et attention, j'utilise ici le terme dans son acception la plus neutre, la plus chiante, la plus plate, celle de “ce qui doit être en conformité”, c’est à dire que cette peine n’est pas une obligation, un élément de la vie avec lequel il faut composer, comprendre cela, a été ma révélation.
Alors comme j’ai démarré un peu en vrac, je rembobine.
Je suis née en 1980 et j’ai grandi en banlieue parisienne. Ma vie n’a pas super bien démarré, puisque mon père était héroïnomane et pas hyper calé niveau communication non violente. Au moment où je suis arrivée sur terre, ma mère était déjà en mode survie. Elle a réussi à nous tirer de ce bourbier, non sans stigmates, si vous voyez ce que je veux dire. L’idée n’est certainement pas de faire pleurer dans les chaumières, mais d’établir un contexte – c’est ce qu’on doit apprendre dans les cours d’écriture auxquels je n’ai jamais assisté. Mon père n’a jamais reçu de diagnostic de maladie mentale, malgré un passage en prison et pas mal de bordel dans sa vie, mais il est clair pour tous ceux qui le connaissaient, que bon, une sacré anguille se cachait sous la roche. Du genre, bipolaire.
J’ai évolué dans ma peau, cahin-caha, comme tout le monde.
Le poids sur la poitrine, les pensées obsessionnelles et morbides, la difficulté de me lever le matin, la sensation de vide et de non sens, l’impossibilité de réguler mes émotions, l’anxiété, les crises de panique, la sensation que tout, absolument tout est une case à cocher avant d’aller enfin dormir et surtout, l’impossibilité de ressentir de la joie, l'incapacité de me réjouir, sont les symptômes qui m’ont accompagnés d’aussi loin que je me souvienne. J’ai cru, très longtemps, que tout le monde vivait de cette manière. Dans une zone en camaïeu de gris. Et puis, j’ai appris que non : cette découverte est très circonscrite puisqu’elle coïncide avec mon premier traitement, durant lequel j’ai pris conscience que toute ma vie jusque-là, n’avait été qu’une longue lutte pour arriver au bout de chaque journée.
C’est difficile à expliquer, la dépression. Lorsque je me relis, les mots me paraissent délavés, vidés de la substance même de leur signification. Rien ne peut vraiment expliquer la notion de fatigue de vivre. Les personnes non dépressives qui liront ces paragraphes, lèveront un sourcil, mais bien-sûr, tout le monde ressent ça, à un moment ou à un autre, c’est le principe même de la condition humaine, la vie n’est pas facile. Oui. Tout le monde a aussi eu une gastro, mais n’est pas pour autant atteint de la maladie de Crohn. Je sais que la comparaison paraît vaseuse, mais, pardon, elle fonctionne. Je me souviens très bien des mots de ma généraliste dans son cabinet, lorsque lors de ma première décompensation, j’ai commencé par refuser le traitement : “Si vous aviez du diabète, m’a-t-elle dit, vous ne rechigneriez pas autant à vous soigner.”
Lorsque j’écris ces lignes, nous sommes le 22 février 2022. Je viens de passer mes dix jours de vacances terrée dans mon appartement sans me résoudre à en sortir. Je me suis fait violence, chaque jour, pour ouvrir le volets et ranger derrière moi, la seule habitude à laquelle je puisse me tenir – je suis maniaque. J’ai passé dix jours à écouter des podcast de true crime sur Youtube, à compter jusqu'à 100 pour sortir de mon lit, à faire des listes : “manger”, “envoyer ce mail”, “sortir les poubelles”, “changer la litière”, “répondre à ce texto”. J’ai dormi par intermittence, mais surtout pas la nuit – ça va pas non ? La nuit, j’ai les yeux grands ouverts, j’essaie de tenir mes pensées obsessionnelles à distance. La journée, l’anxiété m'écrase et m'immobilise. Penser à manger. J’ai de la chance, je le sais. C’est ce qui me donne envie d’aller hurler dans la forêt, cette conscience de mon confort matériel moral et affectif. Mais pour aller en forêt, il faudrait que je me douche, que je m’habille et que j'aille passer mon permis de conduire. Autant dire que la thérapie du cri primal, c’est pas pour demain.
J’ai senti l’épisode arriver, lentement. La maladie me dévore lorsque je n’ai pas l’obligation de me présenter physiquement au travail. Les autres contraintes, c'est-à-dire le travail à la maison, me forcent à ne pas disparaître complètement des radars. Mes proches ont appris l’indulgence avec mes accès de mutisme, que je ne peux pas me permettre avec mes collaborateurs. Je n’ai pas dépassé ce stade là, celui de l'incapacité à continuer de gagner de l’argent pour vivre. C’est déjà ça. Mais la dépression m’a englouti, une fois de plus. Elle est toujours la plus forte.
Je suis inquiète.
Chaque rechute est plus sombre, plus profonde que la précédente, à ceci près que je sais, maintenant, ce qui m’arrive. J’ai vécu près de 37 ans sans comprendre cette anomalie qui m'accompagne depuis l’enfance. J’ai longtemps cru être folle, inadaptée, lâche, sans volonté ; j’ai longtemps pensé que tout ce qui m’arrivait était bien fait pour moi. Aujourd’hui, je peux voir la vague arriver, essayer de ne pas me submerger totalement, mais je ne peux pas les empêcher de refluer avec toujours plus de violence.
Le seul moyen de tenir le vide à distance, c’est d’écrire.
C’est insupportable de privilège, je le sais, ne m’en voulez pas. Et puis, sans déconner, cet adage flingué : L’écriture m’a sauvé la vie, on a encore le droit de l’utiliser sans tomber dans une faille spatio-temporelle menant tout droit au purgatoire des mauvais auteurs ? Mais je ne sais pas quoi écrire d’autre pour ne pas mentir. Je ne peux survivre à une journée de plus qu’en rédigeant ces lignes, puisque je suis en capacité de le faire, puisque les mots sont faits pour nous lier les un.e.s aux autre et qu’ils sont les seuls outils que je puisse utiliser pour faire résonner quelque chose dans ce monde qui me terrifie.
Pour vous dire que je vous entends. Je ne suis personne, je le sais bien. Je suis juste celle qui a le droit de parler à travers cette plateforme. Dire que je vous vois, ce n’est pas me mettre en posture de soignante, de sachante, de dominante : c’est juste utiliser un assemblage de syllabes que j'aurais aimé lire, venant de n’importe qui, pourvu qu'il ou elle n’essaie pas de me faire croire en quelque chose. Juste cela : être vue. Je ne peux pas vous empêcher de penser que tout est de votre faute, ni dissiper la brume qui grandit dans votre cage thoracique et vous suffoque. Je ne peux pas vous empêcher de ressentir que vous n’êtes lâche, fou.folle, inadapté.e, ou sans volonté. Je peux juste vous dire que je vous comprends, et je pleure en écrivant ces mots.
Je ne sais pas comment décrire le néant qui vit en moi. Je sais que, s’il a colonisé votre corps, vous savez de quoi je parle, je n'ai pas besoin de trouver les mots pour vous persuader.
Pour les autres, laissez tomber l'intransigeance – ne pas sortir de chez soi, vraiment ?– et comprenez : la dépression est d’autant plus difficile à subir qu’on ne sait pas bien ce qu’elle est. Il n’y a pas d’auto-complaisance cachée dans ces interlignes : le peuple du Néant se juge avec la plus impitoyable des méchancetés et sans aucune pitié pour lui-même. Toutes les objections, les remarques acerbes, les analyses éclairées, nous nous les sommes déjà imposées. Le peuple du Néant, c’est le mien et autant vous dire que nous ne sommes pas vraiment prêts à envahir qui que ce soit. Nous sommes une armée silencieuse qui donne souvent très bien le change, nous évoluons parmi vous sans que vous puissiez vous douter que tout ce que nous faisons est cela, une chose à faire, des tâches les plus chiantes aux occasions les plus formidables. Nous sommes des fantômes souriants, parfois très drôles (moi je suis hilarante par exemple, en toute objectivité), doués, attentionné.e.s, parfois très cons, il n’y pas pas de règle, toutes les catégories sont représentées dans notre immense bande et il n’y a pas d’examen d’entrée ni de pré-requis particuliers pour en faire partie.
Je ne suis pas ici pour vous dévoiler une quelconque recette miracle, les recettes miracles sont comme le bonheur : elles n’existent pas.
J’écris pour parler de la dépression, c’est tout. Juste : en parler. La forme que cela va prendre ne sera sûrement pas exhaustive, mais j’ai besoin de me poser toutes les questions qui me taraudent, pour tenter d’y répondre avec mes mots, mes lacunes et mes fausses conceptions. Pour avancer, avec vous pour partenaires dans ce voyage.
Bisou les aminches, n’hésitez pas à faire un coucou en commentaire, pour la bise ou le sentiment, je lis tout.