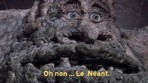Ma prise de conscience
Arriver au bout et ne pas faire demi-tour


Trigger-warning : cet article fait mention de la notion de suicide. Prenez-soin de vous.
Bon.
Dans le parcours de la dépression, il y a souvent un moment charnière, celui de l’illumination, de la révélation, de la mise en mots. Parfois, souvent, la maladie est objectivée par une tierce personne, qui énonce les choses avec le détachement naturel de ceux qui ne sont pas concernés directement. Pour moi, puisque je suis ici pour essayer d’élargir le sujet en partant de mon expérience, la prise de conscience a eu lieu en deux temps, dont le premier théâtre a été le cabinet du médecin généraliste, ce qui, si l’on en croit les études très sérieuses sur le sujet, est banal et surtout, très fréquent.
Selon cet article du BMC public health publié en 2007, le point d’entrée dans le monde merveilleux de la dépression se ferait principalement en poussant la porte du cabinet du médecin de quartier : 57,8 % de l’échantillon de population observée pour cette étude s’est dirigé naturellement vers lui ou elle pour une première consultation et un peu moins de la moitié de ce même échantillon continuera de le.la consulter au lieu d’aller voir un professionnel du genre, thérapeute, psychologue ou psychanalyste (nous reviendrons sur l’orientation vers les spécialistes et le coût de la santé mentale plus tard, je ne veux pas m'égarer).
Lorsque je me suis enfin décidée à aller consulter, je sortais de près d’un mois sans sommeil : je somnolais péniblement la nuit, attaquée par des images morbides dès que mes paupières se fermaient ; je ne mangeais quasiment plus – je maigrissais à vue d’oeil – dégoûtée par les aliments, zombifiée par la fatigue, les palpitations, les pensées obsessionnelles, la peur de ne jamais me réveiller si je finissais par vraiment dormir.
L’idée d’ouvrir la fenêtre pour mettre fin à la marche de mon cerveau qui partait en toupie m’a effleurée, plus par envie de faire un reset que dans l’idée de mourir – c’est un autre aspect très intime et dérangeant de la dépression, l’idée que l’on puisse aimer profondément la vie, tout en traversant des épisodes si insupportables et difficiles que l’envie de ne plus la subir devienne une option valable.
Mais ce qui m’a forcée à prendre rendez-vous avec ma généraliste, ce n'est pas ça. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a fallu que j’atteigne ma limite personnelle, qui peut sembler bien dérisoire au regard des symptômes que vient d’énoncer. Ce qui m’a obligée, c’est un incident survenu au travail, un banal accrochage avec un collègue que j’aimais beaucoup et avec lequel je m’entendais bien. Je ne suis pas du genre à me formaliser au boulot : ce que j’ai appris en 15 ans de carrière, c’est que les gens sont parfois de mauvaise humeur, que les cafouillages peuvent entraîner des malentendus et que la pression peut faire dire n’importe quoi. Il m’est arrivé néanmoins de me vexer ou de faire la gueule : lorsqu’on travaille en équipe avec les mêmes personnes plus de 10 ans, on devient une famille dysfonctionnelle, capable de tiquer pour des broutilles invisibles à des yeux étrangers, comme de se pardonner mutuellement sans plus jamais revenir sur ce qui a pu déconner. Mais, dans ce cas précis, la petite dispute sans conséquence m’a broyée. Je me suis vue, comme sortie de mon corps, toquer à la porte du bureau de mon directeur, m'affaler sur une chaise en face de lui, pour éclater en sanglots incontrôlables pendant près de 10 minutes (c’est long dix minutes).
Je n’avais jamais pleuré au travail (si : une fois. Après le décès d’un élève de mon établissement, j’étais intervenue auprès de ma classe sur les conseils de la psychologue scolaire. “Dis-leur les choses simplement”, m’avait-elle conseillé. Passé le choc, les questions des enfants fusaient : “Mais il ne reviendra jamais ?” Non, avais-je répondu. “Il ne reviendra jamais.” Les larmes coincées dans ma gorge, je ne voulais surtout pas pleurer devant eux, ne pas les mettre en insécurité, leur montrer que je gérais. Mais à seize heures, en les menant vers la sortie, un élève très discret, de ceux qui ne posent jamais beaucoup de questions, était resté en arrière pour se trouver seul avec moi et m'interroger doucement : “Maîtresse, tu sais où il va être enterré ?” Prise de cours par le pragmatisme de sa question, j’avais bégayé une négation, le voyant s’enfuir presque aussitôt, gêné d’avoir osé me solliciter. Là, à la sortie de l’école, oui, j’ai pleuré.)
L’air désolé de mon directeur, tandis qu’il me tendait des mouchoirs à intervalle régulier, a été ma limite. Dans ses yeux, j’ai perçu une empathie et un désarroi que je ne ressentais pas pour moi-même. “Promets-moi d’aller chez le médecin en sortant du boulot”, m’a-t-il suppliée. J’ai promis.
Sans surprise, à l’annonce de mes symptômes, ma généraliste a fait ce que font la plupart de ses collègues en la matière ; elle a verbalisé. Le choc a été d’une telle amplitude – une dépression, moi ? – que j’ai d’abord commencé par refuser d'entendre les mots qui sortaient de sa bouche. Ça allait rentrer dans l’ordre, j’étais juste fatiguée. L’habitude de vivre avec mes empêchements était trop forte, ils étaient mes compagnons de route, ils étaient ma normalité. L'épuisement les rendait juste plus envahissants. Il me fallait un décontractant musculaire et un bon somnifère, voilà tout. Elle n’a pas cédé. Non, là, il allait falloir bouger les lignes, entamer un travail, creuser un peu dans le caca. Elle était désolée, mais elle n’allait certainement pas me laisser ressortir de son cabinet après que j’ai prononcé les mots “Je veux juste que ça s'arrête”, sans me surveiller un tout petit peu.
Les généralistes sont en première ligne dans le diagnostic de la dépression, je l’ai déjà évoqué plus haut : ce que met en lumière cet article de la revue L’Information Psychiatrique sur la prise en charge de la dépression en France, c’est que “la majorité des médecins généralistes de ville ont déclaré prendre en charge, chaque semaine, des patients présentant une souffrance psychique (72 %), des troubles anxieux (82 %) ou un état dépressif (67 %)”. Ils sont le pare-feu, la première ligne, le cordon de sécurité qui maintient, tant que bien que mal, la sécurité relative de leurs patients. Leur formation sur la gestion de la santé mentale, si elle existe bien, n’est pas toujours approfondie : en effet, sur le panel évalué, “la majorité des participants (84 %) s'estiment suffisamment formés sur le diagnostic ou le traitement de la dépression” mais sont “également demandeurs de formations complémentaires (...).”
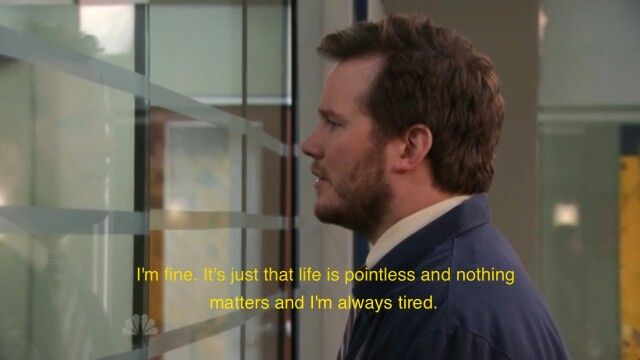 Moi, chez le médecin : "Je vais bien. C'est juste que la vie n'a pas de sens et que rien n'a vraiment d'importance et que je suis toujours épuisé.*
Moi, chez le médecin : "Je vais bien. C'est juste que la vie n'a pas de sens et que rien n'a vraiment d'importance et que je suis toujours épuisé.*
La réponse qu’ils apportent au patient est généralement médicamenteuse : dans mon cas, cela n’a pas loupé (et je formule cette phrase sans aucun mépris ni ressentiment, car cet épisode “médical” m’a sauvée) : on m’a prescrit un antidépresseur de la famille des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. J’ai donc suivi et c’est amusant (enfin, pas vraiment) de le constater, le parcours tout tracé de la française moyenne face à la maladie. Mon ordonnance en poche, je me suis rendue à la pharmacie de quartier pour me procurer la sacro-sainte boîte qui mettrait, peut-être, fin à mon calvaire.
Mais la prise de conscience n'était pas totale. Telle une Céline Dion sans talent vocal, j’aurais pu chanter, mal, à tue-tête : “J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris, merci”. Or, comprendre n'est pas accepter. Il me fallait encore parcourir la distance entre le diagnostic et l’envie de remédier au mal et ce n'était pas gagné. L'orgueil, le déni, la peur de flancher, mes préjugés sur la dépression, étaient trop ancrés, trop intériorisés, pour me laisser la latitude de m’abandonner à l’idée même de souffrir de dépression.
Le deuxième temps de ma prise de conscience a été d’une autre nature : comme souvent dans ma vie, c’est un élément de pop culture qui a illuminé mon paysage mental. À cette époque, je me faisais saigner les oreilles avec l’album Speedin’ bullet to heaven de Kid Cudi, sorti en 2015. J’avais déjà bien fait tourner Man On The Moon : The End Of Day sur lequel figure le légendaire et bien nommé Pursuit of happiness : j'éprouvais de la sympathie pour le chanteur-compositeur, enclin à évoquer le mal de vivre dans ses paroles. Si je ne suis pas particulièrement l'actualité des artistes que j’aime, lorsque je suis tombée sur ce post Facebook du 5 octobre 2016, quelques jours après avoir décompensé dans le cadre de mon travail et consulté mon médecin dans la foulée, je l’ai lu avec beaucoup d’attention.
Ce qu’il a éveillé en moi est indescriptible. Les mots de Scott Mescudi, alias Kid Cudi, lorsqu’il explique pourquoi il a décidé d’entrer en centre de désintoxication “pour dépression et pulsions suicidaires”, ont eu bien plus d’écho que ceux de mon médecin ou de mes proches. Je sais pourquoi : ce sont les mots d’une personne souffrant de troubles dépressifs, bien plus précis, bien plus affûtés que ceux de n'importe qui d'autre, des mots qui portent le poids de la réalité, qui vont au plus près, tant que faire se peut avec de la matière intangible, de la véracité de la maladie.
...